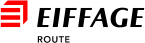Comment le retraitement en place de chaussées
permet-il de réhabiliter des voiries ?
La réhabilitation des routes peut être une opération coûteuse et chronophage pour les collectivités publiques en charge des voiries. Fort heureusement, une technique durable et économique a émergé et fait ses preuves sur de nombreuses routes nationales et départementales :
le retraitement en place de chaussée.
En réutilisant la chaussée existante comme base matérielle pour une nouvelle couche de roulement, cette technique offre des avantages considérables, tant sur le plan économique qu’écologique.
Dans cet article, nous vous démontrons en quoi le retraitement en place de chaussée s’impose comme la solution de premier choix pour remettre en état vos routes et voiries.
Le retraitement en place de chaussée, qu'est-ce que c'est ?
Le retraitement en place de chaussée est une technique routière éprouvée depuis plusieurs années, sans cesse remise au gout du jour grâce à l’innovation des matériels et des techniques de recyclage des matériaux. Depuis 2003, elle est régie par un guide du Setra*, et a été éprouvée sur de nombreux axes routiers français, sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce procédé est utilisé pour réhabiliter les routes en mauvais état, en utilisant une approche économique, sobre, durable et écologique. Il consiste à réutiliser les matériaux déjà présents dans la chaussée à retraiter pour recréer, à partir de ceux-ci, une nouvelle route, régénérée sur place.
*Setra : Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements. Service technique français à compétence nationale du ministère de la Transition écologie dont la tutelle est exercée par la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.

Recytal®ARM - RD 19 - Saint-Étienne-des-Champs - Combrailles
Comment ça marche ?
Le processus de retraitement en place de chaussée commence par le broyage et le concassage de la couche supérieure de la chaussée existante. Le matériau est ensuite mélangé avec un liant d’apport, pour créer une nouvelle couche de chaussée. Celle-ci est ensuite compactée pour créer une surface plane, reprofilée et dotée d’un uni rectifié.
Pour réaliser l’ensemble du processus, l’entrepreneur des travaux est généralement équipé d’un « atelier de retraitement mobile » (machine à grande capacité qui rabote, et concasse la chaussée usagée). Celui-ci est alimenté par un camion-citerne compartimenté contenant le liant et l’eau. Son action est complétée par les matériels routiers classique (un finisseur et un compacteur), chargés respectivement d’appliquer les matériaux retraités et de les compacter en une surface lisse au roulement.
Les avantages du retraitement en place de chaussée
Le retraitement en place de chaussée présente plusieurs avantages par rapport aux techniques traditionnelles de réhabilitation de chaussées.
Tout d'abord, il permet d'économiser du temps et des coûts. Le gain de temps est assez évident à intégrer. Une opération de retraitement en place rénove en moyenne 5 à 7 000 m² de chaussée / jour ! Ce qui représente un gain de temps de 30 à 50% par rapport à un chantier de réhabilitation classique de chaussée.
Arrêtons-nous donc un instant sur les économies possibles.
-
Parmi les principaux coûts d’entretien de voiries, il y a ceux induits par l’évacuation des matériaux usagés. Le retraitement en place offre l’avantage de se passer de cette évacuation de matériaux. Un aspect non négligeable car les coûts de mise en décharge peuvent être assez élevés, surtout si les déchets évacués sont identifiés comme pollués à l’amiante ou aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques – anciennement connus sous le terme « goudrons »). Dans ces cas-là, des techniques de retraitement en place spécifiquement prévus pour les chaussées polluées sont à privilégier.
-
Cet avantage va de pair avec l’économie de mise en décharge. Le retraitement en place utilise directement les matériaux de la chaussée à réhabiliter, qui sont alors recyclés et instantanément réappliqués en place. L’opération se passe donc de l’approvisionnement de granulats neufs issus de carrières. Selon que ces dernières se trouvent plus ou moins éloignées du chantier, l’approvisionnement peut donc s’avérer coûteux. Ce qui fait du retraitement en place une option économique en plus d’être durable et écologique (car elle préserve la ressource naturelle minérale).
-
En sus de la préservation des carrières, le retraitement en place présente l’avantage de consommer moins d’énergie et donc de générer moins de gaz à effet de serre. Une opération classique de rénovation de chaussée mobilise en moyenne 80 poids lourds par kilomètre retraité, avec pour chacun d’entre eux une consommation de carburant et des émissions de CO2 (60 kg de CO2 émis pour 20 km). En retraitant la chaussée en place, seuls 4 engins sont nécessaires pour réhabiliter plusieurs kilomètres de voirie !
Toujours dans le sens de la sobriété énergétique, il est important de noter que ce genre d’opération se fait « à froid ». Un entretien traditionnel de chaussée nécessite de chauffer le bitume à haute température pour qu’il se mélange au mieux aux granulats, pour ainsi former le revêtement final. Le retraitement en place présente la particularité de fonctionner à température ambiante ! -
Cette solution de retraitement de voirie cumule donc les aspects recyclage et sobriété énergétique (moins de poids lourds nécessaires à la réfection de la route, donc moins de carburant utilisé) qui en font une solution très intéressante du point de vue de la maîtrise des émissions de carbone liées à la construction.
Il est toutefois possible d’aller encore plus loin dans la réduction de l’impact carbone de ce type de chantier, et ce, en optant pour sa version « sans pétrole ajouté ». En remplaçant l’émulsion de bitume classique (d’origine pétrolière), par un liant d’origine végétale (biosourcé), le bilan carbone chute et devient même négatif !
Cette émulsion végétale est issue de la culture du pin. L’analyse de son cycle de vie montre qu’en utilisant ce liant nouvelle génération, le maître d’ouvrage bénéficie également du crédit carbone obtenu par les éléments qui le constituent. Autrement dit, le pin dont est issu le liant végétal, ayant capté du CO2 et rejeté de l’oxygène tout au long de sa culture, lui confère ce bilan carbone. L’infrastructure qui en résulte voit donc elle aussi son impact carbone drastiquement réduit grâce à ce crédit. En moyenne, 1 m² de chaussée retraitée avec ce procédé végétal permet de « stocker » 4 kg de CO2 (calculé via l’éco-comparateur SEVE). -
L’entretien du réseau routier entraine généralement son lot de perturbations pour les usagers et riverains. Les premiers doivent généralement s’adapter aux routes fermées, barrées ou encore aux circulations alternées et itinéraires déviés. Les seconds doivent eux faire avec le bruit et le surplus de trafic engendré par les nombreux engins de chantiers. Les caractères « furtif » et sobre en engins offerts par le retraitement en place permettent donc aux maîtrises d’ouvrages en charge des voiries de réduire grandement ces nuisances.
Le retraitement en place de chaussée est-il adapté à votre projet ?
Le retraitement en place de chaussée peut ne pas être approprié dans toutes les situations. Quelques sondages préliminaires et un recueil de données trafic sont nécessaires pour valider la faisabilité de la technique.
De plus, les techniques à froid nécessitent un temps de séchage ce qui sous-entend une réalisation par bonne météo, idéalement entre mi-avril et fin août.
Réhabiliter vos voiries grâce au retraitement en place de chaussée
En résumé, le retraitement en place de chaussée est une technique de réhabilitation de chaussées durable, économique et écologique qui permet de réutiliser les matériaux de la chaussée existante comme ressource de la nouvelle route, en un temps record. Elle peut être une option économique de réhabilitation des routes en mauvais état. Cette solution est par ailleurs plus respectueuse de l'environnement car moins énergivore, moins consommatrice de ressources, moins gênante pour les usagers ou riverains, et parfois créditrice en carbone dans sa version la plus écologique (liant biosourcé, sans pétrole).